3 avril 2025
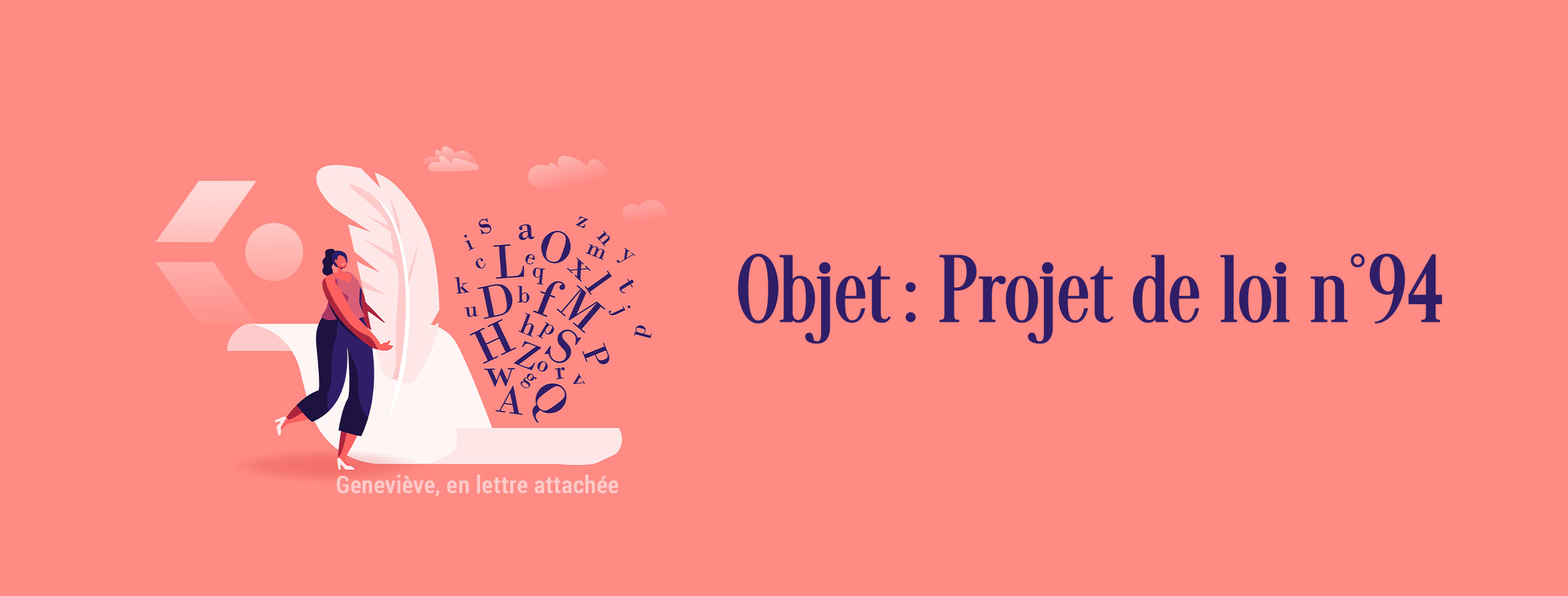
Renforcement de la laïcité dans le réseau de l’éducation :
Une réponse aux dérives. Semblerait-il que, dans notre société, nous éprouvions des difficultés avec le respect de certaines consignes établies pour le bénéfice du vivre-ensemble et que nos dérapes servent de prétexte aux autorités pour se doter de moyens rigoureux afin de faire appliquer les règles. En l’occurrence, le gouvernement élabore des projets de loi pour justifier l’application de son pouvoir coercitif sur la population. La loi visant à renforcer la laïcité dans le réseau de l’éducation et modifiant diverses dispositions législatives en est un exemple frappant.
Le grave événement survenu à l’école Bedford a mis en lumière les lacunes du système éducatif en matière de laïcité. Le rapport d’enquête a révélé un climat toxique et des comportements inacceptables, poussant le gouvernement à réagir. La CAQ a ainsi déposé le projet de loi n°94 proposant une série de modifications législatives visant à resserrer le cadre prévu en ce qui a trait à la laïcité au sein du système d’éducation québécois. Ce projet de loi est une réponse directe aux dérives observées, cherchant à garantir un environnement scolaire sain et sécuritaire tant pour les élèves que pour l’ensemble du personnel y œuvrant.
Le problème est que la Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes ainsi que la Loi sur la laïcité de l’État prévoyaient DÉJÀ l’obligation de respecter les principes fondamentaux de la laïcité de l’État soit la séparation de l’État et des religions, la neutralité religieuse de l’État, l’égalité de tous les citoyens et la liberté de conscience et la liberté de religion, en plus de l’interdiction du port de signes religieux et l’obligation d’avoir le visage découvert à certaines personnes dans l’exercice de leurs fonctions. Ces lois donnaient DÉJÀ aux gestionnaires l’autorité d’appliquer ces principes pour permettre à quiconque d’évoluer dans un système fondé sur des valeurs démocratiques et égalitaires. Pourquoi alors n’ont-ils pas fait cesser la situation alors qu’ils en avaient les moyens ?
Quoiqu’il en soit, le gouvernement a saisi l’occasion pour renchérir et élargir la portée de ses restrictions, à la suite des quelques dérives médiatisées. À de nombreuses reprises, le projet de loi réfère aux conduites et pratiques attendues; il répète et insiste sur les obligations de faire respecter l’égalité entre les femmes et les hommes, les comportements exempts de considérations religieuses, l’interdiction du port de signes religieux et l’obligation d’être à visage découvert.
Pour le respect des fondements du système laïque, visant une offre de services éducatifs de qualité, universels et dispensés dans un milieu éducatif sain et sécuritaire, le projet de loi n°94 contraint aussi le personnel à fournir ses planifications annuelles conformément aux pratiques et régimes pédagogiques laïques et à utiliser exclusivement la langue française sur son lieu de travail. Il exige en plus des directions qu’elles fassent respecter l’ensemble des obligations prévues, par différents moyens, notamment l’évaluation annuelle du personnel.
La doléance, mise en évidence ici, repose sur le fait que toutes ces « nouvelles obligations » sont en fait DÉJÀ prévues par une panoplie de lois et de régimes politiques. Pourquoi alors la CAQ ressent-elle le besoin de les répéter, de les inclure partout, de renforcir ses règlements et de prescrire de nouveau ce qui doit DÉJÀ être impérativement effectué ? Est-ce parce que ceux qui en ont DÉJÀ l’autorité d’application ne le font pas ? Ne serait-il pas plutôt pertinent que le gouvernement utilise sainement son leadership pour s’assurer que les lois DÉJÀ en place soient appliquées dans les milieux plutôt que de rajouter des couches administratives ?
Le concept de laïcité au Québec repose sur une volonté que chacun sente qu’il a sa place au sein de la collectivité. La neutralité assure à tous la possibilité de vivre en paix et d’être traité dignement et de façon équitable. Le respect de la différence devrait être systématique. Ce sont là quelques-unes des valeurs, parmi bien d’autres, que le Syndicat de Champlain préconise et à travers lesquelles il s’assure de défendre les droits de tous les membres qu’il représente.
Geneviève Bourbeau
Coordonnatrice du Syndicat de Champlain

